En France, tout le monde a une image en tête quand on dit cagole : une cagole marseillaise, verbe haut, look appuyé, humour XXL. Mais derrière la caricature, la cagole de Marseille est aussi un fait social : une façon d’afficher une hyperféminité, de jouer avec les codes, parfois de les subvertir. Cet article démêle les définitions, origines, clichés, réappropriations et usages culturels du mot — sans oublier une bonne dose d’auto‑dérision (Marseille oblige).
Qu’est‑ce qu’une « cagole » ? (définition moderne)
- Usage courant. Dans l’argot du Sud (surtout Marseille), cagole désigne une jeune femme — ou femme — très apprêtée, exubérante, parfois provocante, au parler fleuri. Le terme oscille entre moquerie et tendresse selon qui parle et à qui il s’adresse.
- Nuances sémantiques. Le mot peut être péjoratif (vulgarité, « trop tout ») ou affectueux (auto‑dérision marseillaise). Le contexte, l’intonation et la relation entre locuteur·ice·s comptent autant que le lexique.
- Sociolinguistique. C’est un stéréotype féminin codé par un look et un ethos (gestuelle, accent, bagou), plus qu’une catégorie sociale fixe.

Illsutration par intelligence artificielle d’une Cagole de Marseille
Une cagole est une femme stéréotypée du Sud de la France, souvent exubérante, très apprêtée, bavarde et parfois provocante. Elle incarne une caricature féminine populaire, typiquement associée à Marseille.
Origine du mot « cagole » (histoire & étymologie)
Un mot à l’étymologie discutée. Les spécialistes s’accordent sur le caractère marseillais du terme, mais pas sur son origine exacte. Deux pistes reviennent le plus souvent :
La piste occitane/provençale. Rattachement possible à l’occitan cagòla ou à cagoulo (cagoule/tablier). Dans le Marseille industriel du tournant XXᵉ, des ouvrières portaient un long tablier et parfois une coiffe pour des raisons d’hygiène. Par glissement métonymique (du vêtement à la personne), cagole en serait venu à désigner certaines femmes du milieu populaire. Cette explication est plausible mais non démontrée – elle relève en partie de la folk‑étymologie.
La piste du « cacou/kakou ». À Marseille, kakou désigne un mec frimeur. Par analogie sociale et jeu de genres, cagole a souvent été perçu comme l’« équivalent féminin ». Ce rapprochement sémantique ne signifie pas forcément une parenté étymologique directe.
Premières occurrences et sens ancien. Les attestations début XXᵉ siècle (Marseille) emploient cagole au sens de fille de petite vertu ou prostituée, avec une forte charge morale. Le terme est donc péjoratif à l’origine.

Glissements de sens (XXᵉ–XXIᵉ siècles).
-
1950–1980. Le mot s’étend dans l’oral populaire au‑delà du seul contexte prostitutionnel.
-
Années 1990–2000. La culture médiatique popularise l’archétype : femme tape‑à‑l’œil, bavarde, très apprêtée.
-
Années 2010–2020. Réappropriations humoristiques et parfois féministes ; à Marseille, on s’en moque… mais entre soi.
Statut pragmatique aujourd’hui. Cagole reste un mot familier à potentiel injurieux. Selon le contexte, l’intonation et la relation entre les personnes, il peut sonner affectueux, taquin, ironique… ou méprisant.
Le look « cagole » : maquillage, tenue, gestuelle
Checklist (indicative, avec auto‑dérision)
Cheveux : brushing volumineux, blond peroxydé ou noir corbeau ; chignon haut « qui tient au mistral ».
Make‑up : contouring marqué, sourcil dessiné, mascara abondant, gloss ou rouge éclatant.
Tenues : matières brillantes, minijupe ou robe très moulante, leggings ajourés, décolleté généreux.
Accessoires : créoles XXL (alias « perchoirs à perruche »), gros bracelets, strass et paillettes.
Chaussures : talons hauts ou baskets compensées.
Gestuelle/ethos : débit rapide, accent chantant, franc‑parler, rire sonore, posture assumée.
1980‑2000. L’esthétique « bling‑glam » popularisée par la pop culture a nourri l’archétype. Aujourd’hui. Les codes se mélangent (streetwear + glam). Le style « cagole chic » existe : même panache, plus de dosage.

Illsutration par intelligence artificielle d’une Cagole de Marseille
La Cagole dans la culture populaire
Télé‑réalité & TV : la figure s’invite (ou est caricaturée) dans certains formats (accent, look, crêpage de chignons).
Scène & humour : la « cagole » est un rôle comique récurrent (personnages, stand‑up, théâtre marseillais), souvent joué en second degré.
Musique, BD, pub : l’archétype sert de code visuel : couleurs chaudes, soleil, mer, auto‑dérision sudiste.
Perception hors de Marseille : entre curiosité folklorique et cliché réducteur ; à Marseille, on rit de soi… mais l’extérieur n’a pas toujours le droit de le faire (question de légitimité et d’insider/outsider).

Les équivalents masculins : kakou, kéké, beauf… « un cagol » ?

Les équivalents masculins : kakou, kéké, beauf… « un cagol » ?
À Marseille, l’alter ego masculin le plus cité est le kakou (mec clinquant, voiture tunée, look tape‑à‑l’œil).
Plus largement en France, on parle de kéké ou de beauf.
Un cagol ? On l’entend parfois par jeu ou par renversement des rôles. La tendance contemporaine brouille les genres : la « cagole » devient état d’esprit, non essence féminine.
Ni moquerie gratuite, ni glorification aveugle. La « cagole » est à la fois un folklore dont Marseille se joue, une caricature héritée de rapports sociaux très situés, et une réalité vécue par des femmes qui se réapproprient (ou rejettent) ce label.

Sources :
Voici la liste complète des sources ayant permis la rédaction de cet article sur la cagole de Marseille
Définition et usage courant
-
Le Robert. (s. d.). Cagole. Dans Dictionnaire Le Robert. Récupéré le 25 août 2025, de https://dictionnaire.lerobert.com/definition/cagole Dico en ligne Le Robert
-
Larousse. (s. d.). Cagole. Dans Dictionnaire de français. Récupéré le 25 août 2025, de https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/cagole/186892 Larousse
Origine du mot, histoire des sens
-
Tourre-Malen, C. (2021). La figure marseillaise de la « cagole » : hyperféminité assumée versus vulgarité stigmatisée ? Recherches féministes, 34(1), 105-120. https://doi.org/10.7202/1085244ar Érudit
-
Avanzi, M. (2019, 21 avril). Ces particularismes locaux qui se dérégionalisent. Français de nos régions. https://francaisdenosregions.com/2019/04/21/ces-particularismes-locaux-qui-se-deregionalisent/ Français de nos régions
-
Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL). (s. d.). Cagoule [entrée TLFi]. Récupéré le 25 août 2025, de https://www.cnrtl.fr/definition/cagoule Cnrtl
-
Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL). (s. d.). Cagoule [étymologie]. Récupéré le 25 août 2025, de https://www.cnrtl.fr/etymologie/cagoule Cnrtl
-
Mistral, F. (1878). Lou Tresor dóu Felibrige : ou Dictionnaire provençal-français (Tome 1 : A–F). Aix/Marseille : J. Remondet-Aubin. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k74854.image Gallica
-
Mistral, F. (1879). Lou Tresor dóu Felibrige : ou Dictionnaire provençal-français (Tome 2 : G–Z). Aix-en-Provence : J. Remondet-Aubin. https://archive.org/details/loutrsordufelibr02mist Internet Archive
-
Lo Congrès permanent de la lenga occitana. (s. d.). Lo Congrès : ressources et dictionnaires (dicod’Òc). Récupéré le 25 août 2025, de https://locongres.org/fr/ locongres.org+1
-
Orthodidacte. (2023, 21 mai). Étymologie de « cagole ». Dictionnaire Orthodidacte. https://dictionnaire.orthodidacte.com/article/etymologie-cagole Dictionnaire Orthodidacte
Note critique : l’hypothèse « ouvrières des usines de dattes » est mentionnée mais mise en doute pour raisons chronologiques (attestations du mot antérieures à l’usine). Dictionnaire Orthodidacte
Look / codes de la « cagole »
-
Tourre-Malen, C. (2021). op. cit. (analyses d’hyperféminité et de stéréotypisation). Érudit
Culture médiatique et représentations
-
Gasquet-Cyrus, M., & Wharton, S. (2019). « Accent rigolo » et « bouche en cul de poule » : qui minore qui à Marseille ? Minorités linguistiques et société, (12), 81-100. https://doi.org/10.7202/1066523ar Érudit
-
Gasquet-Cyrus, M., & Planchenault, G. (2019). Jouer (de) l’accent marseillais à la télévision, ou l’art de mettre l’accent en boîte. Glottopol, (31). https://glottopol.univ-rouen.fr/telecharger/numero_31/gpl31_06gasquet_planchenault.pdf glottopol.univ-rouen.fr
Équivalents masculins, « cacou/kakou »
-
Larousse. (s. d.). Cacou. Dans Dictionnaire de français. Récupéré le 25 août 2025, de https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/cacou/10910223 Larousse
-
Gasquet-Cyrus, M. (2004). Pratiques et représentations de l’humour verbal : Étude sociolinguistique du cas marseillais (thèse de doctorat, Université de Provence – Aix-Marseille I). https://www.academia.edu/1976689/Pratiques_et_représentations_de_lhumour_verbal_étude_sociolinguistique_du_cas_marseillais
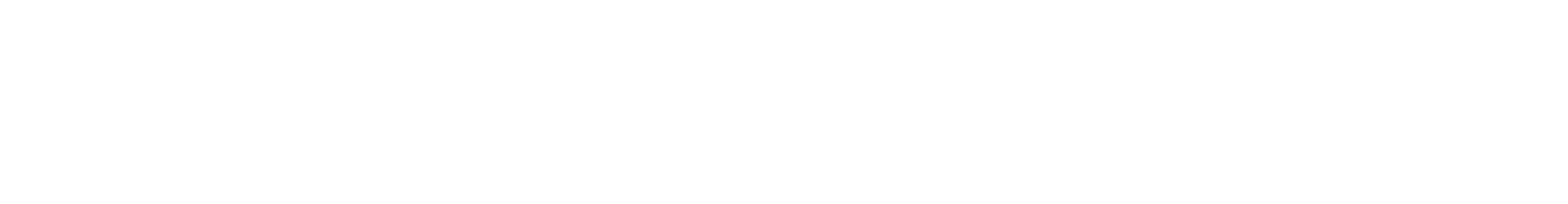










0 commentaires